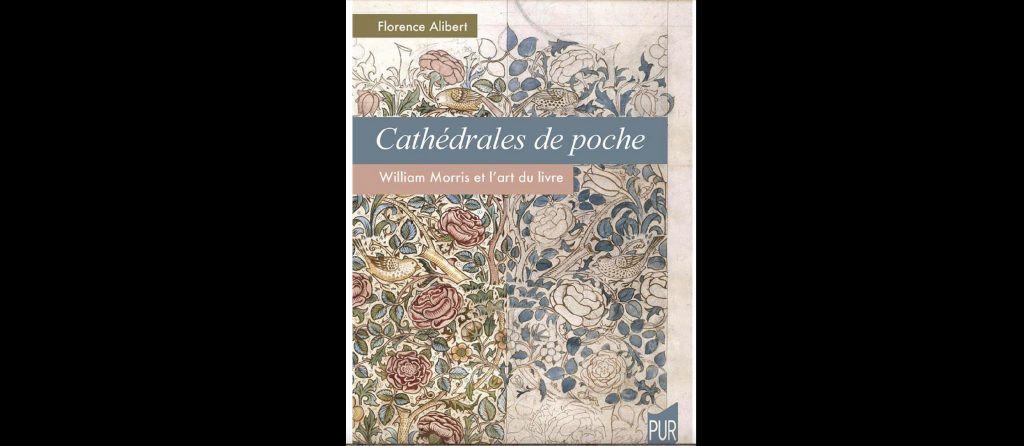
Florence Alibert
Cathédrales de poche
(William Morris et l’art du livre)
Presses universitaires de Rennes, 2024,
297 p., 25,00€
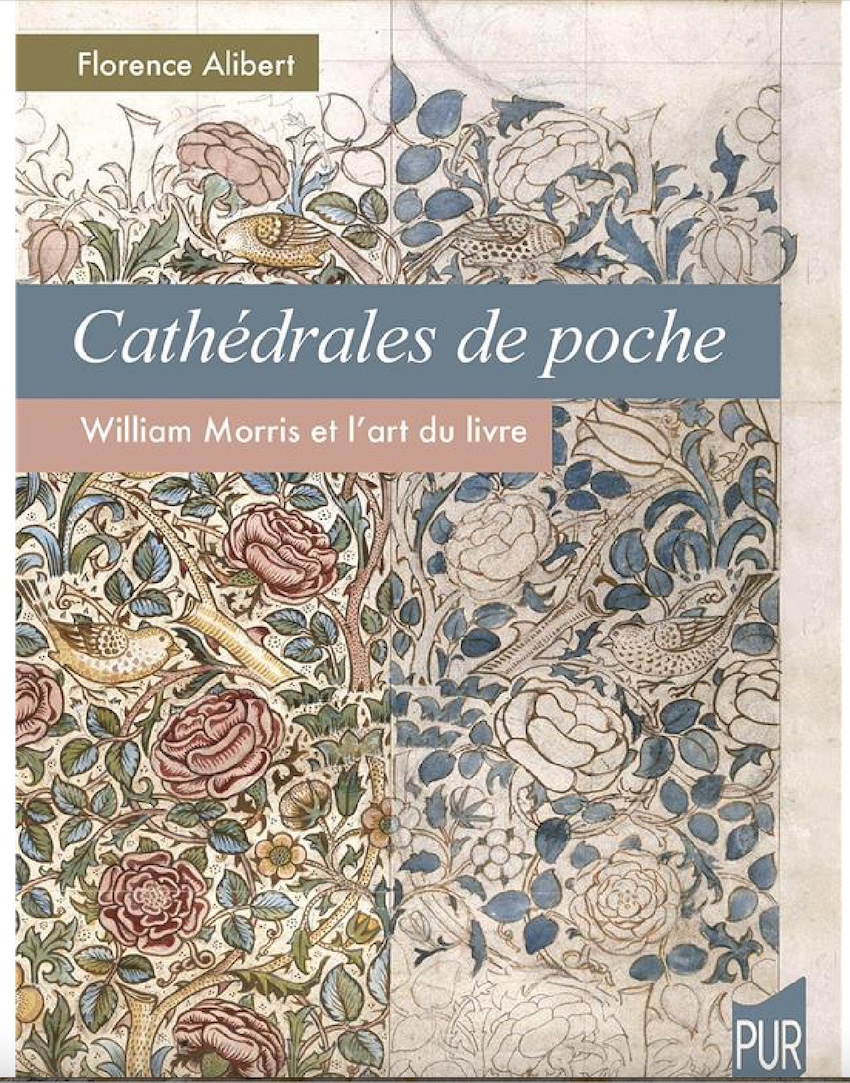
Florence Alibert (maîtresse de conférence à l’Université d’Angers) consacre un bel essai richement illustré et annoté à William Morris (1834-1896) artiste, écrivain, imprimeur-éditeur, bibliophile et esthète engagé. L’auteure nous instruit sur le phénomène typiquement anglais de l’engouement au XIXe pour les « private press », des presses personnelles qui permettent l’autopublication hors des circuits commerciaux (un célèbre exemple en est l’œuvre de William Blake à la fin du XVIIIe siècle). Ce genre de presses existe certes déjà depuis le XVe siècle dans divers pays, mais un tournant s’opère avec le « private press movement » mené par William Morris dans l’Angleterre victorienne qui y trouve « l’expression typographique d’un idéal personnel ». Morris fonde les Kelmscott Press, dont le nom dérive du lieu où il possède son manoir. Florence Alibert examine le fonctionnement de l’entreprise, le processus de production, le management, au regard de l’idéal socialiste de Morris mais aussi au regard des lois du marché. Elle commence par quelques repères biographiques intéressants pour saisir les influences et les pensées, les choix au fondement de ce travail original marquant l’histoire du livre et des arts décoratifs.
Retraçant les étapes de la vie qui pourraient aider à mieux cerner l’œuvre, l’auteure jette un œil sur l’enfance de Morris : les lieux et les édifices gothiques qu’il fréquente, les livres qu’il lit, particulièrement ceux de Walter Scott qui ont éveillé son attirance pour le gothique, le mystère et l’héroïsme sans oublier les motifs ornementaux, notamment végétaux. Alibert examinera plus loin le contenu de la bibliothèque de Morris notant les livres rares qui lui ont servi de modèle et consolidé son exigence esthétique. Les voyages ont également joué un rôle, comme ceux qu’il a faits dans le Nord de la France, en 1855, à pied (par haine des moyens industriels dont le train se fait l’incarnation), afin de visiter les cathédrales qui éveilleront sa passion pour l’histoire du Moyen Âge. Plus tard, un séjour en Islande lui fait découvrir les sagas et la mythologie nordique dans laquelle il puise les valeurs de courage qu’il insère dans une vision politique, qualifiée de « socialisme sentimental » par Alibert. Cela ne l’empêche pas de prôner par ailleurs la violence en faisant appel au Ragnarök, ou « Crépuscule des puissances » (une fin du monde prophétique nordique mise en musique par Wagner dans le Crépuscule des dieux). Il écrit son œuvre majeure à 56 ans, News from Nowhere, qui parut en 1890 d’abord sous forme de feuilleton : « L’ouvrage est une véritable synthèse de la réflexion morrissienne sur l’art, la société, l’histoire et éclaire sous un angle particulier la fondation des Kelmscott Press » dont les projets se discutent dans le quartier londonien de Hammersmith où Morris côtoie, entre autres, Emery Walker avec qui il mène des recherches d’invention de caractères typographiques.
Puisant à la source du marxisme, Morris, qui n’abandonne pas ses exigences spirituelles, se sent parfois proche de Saint-Simon ou de Fourier et il admire l’anarchisme de Proudhon. En tant que patron capitaliste de Morris&Co, il subventionnera de nombreuses actions en faveur du prolétariat et participera à des manifestations violentes (Bloody Sunday, 13 décembre 1887). Mais il demeure un patron et appartient à une classe privilégiée. L’on voit ainsi que la force de l’entreprise de Morris ne saurait se comprendre sans les convictions de son créateur dans différents domaines idéologiques, moraux, métaphysiques. Aussi Alibert analyse-t-elle les engagements politiques, spirituels et moraux, entrant parfois en contradiction les uns avec les autres. L’idée maîtresse de Morris (déjà mise en avant par Platon), celle qui le porte durant toute sa vie, est celle selon laquelle le beau (transposé ici dans le beau livre) détient une portée éducative, indissociable du « bon ». Par-là même, il se communique et s’avère d’emblée porteur d’une dimension sociale. Le livre idéal que veut réaliser William Morris réussit une alliance entre le fond et la forme, sa dimension esthétique absolue entre en connivence avec les dimensions spirituelle et sociale. En ce sens il est une construction qui offre à l’homme sa place car il doit aller de l’œil au cœur.
Du côté des arts, Morris est influencé par le courant préraphaélite représenté d’abord par une première génération avec le peintre Dante Gabriele Rossetti. Morris s’inscrit, avec Edward Burne-Jones, dans le courant de la deuxième génération. Tous deux tentent d’unir illustration et littérature, comme en témoignent d’abord le périodique « The Germ » (dont le titre s’accorde avec la dimension organique qu’un Ruskin attribue au gothique et l’on notera l’attrait pour les deux fleurs mystiques que sont le lys et la rose). Les nombreux projets avortés ou non de Morris et Burne-Jones montrent les difficultés à les réaliser. L’un des modèles du livre illustré sera pour Morris le fameux Hypnerotomachia Poliphili publié en 1499 par le célèbre imprimeur vénitien, Alde Manuce, dont il germanisera cependant la gravure car sa préférence va à la force du gothique au détriment de la délicatesse italienne. Lecteur de Carlyle et Ruskin (1), c’est dans les écrits de ce dernier que Morris reçoit une vraie révélation.
Pour mieux expliquer le choix nordique-gothique contre le clacissisme latin, Alibert fait appel aux théories de Wilhelm Worringer et se penche particulièrement sur son livre l’Art gothique. Plus qu’un moment historique ou architectural, le gothique apparaît ainsi comme « une ligne psychologique septentrionale de délimitation du goût ». En dernière instance, le gothicness est une vision du monde.
Après avoir mis en évidence les idées et l’activité politiques indissociables du travail artistique de Morris, Alibert examine la façon dont le livre se fabrique, à travers une harmonisation entre les illustrations, le texte, la mise en page, la qualité du papier, la typographie. Rien n’est laissé au hasard, tout est pensé, soigné, réfléchi, travaillé, inventé. Morris crée par exemple un caractère gothique, le Troy (1891), duquel il fait dériver une autre police, Chaucer, nommée d’après l’auteur des Contes de Canterbury car il lui importait de trouver un caractère typographique qui correspondît au contenu de l’œuvre, aux poèmes de Chaucer. Il construit donc, avec Burne-Jones, The Works of Geoffrey Chaucer (2), travail exténuant dont le résultat est qualifié de « cathédrale de poche » par Burne-Jones. Epuisé, Morris décède l’année de la parution de cette « cathédrale de poche » qui, par son être même, par sa concrétude esthétique associant l’épique et l’ornemental, insuffle les idéaux qui sont à l’origine de l’entreprise.
Tournant son regard vers les cieux français, bien différents, Alibert met en parallèle la vision du livre idéal de Mallarmé et celle des préraphaélites qui s’opposent toutes deux, pour ne se rencontrer que dans leur opposition à la banalisation du livre produit de façon industrielle. Il faut se diriger vers le Nord de l’Europe pour trouver les répercussions de l’œuvre de Morris. Son projet d’un éveil à l’esthétique par l’intermédiaire du livre se communiquera dans des pays comme l’Allemagne (Kessler et les Cranach Press qui « représentent l’héritage paneuropéen de Morris) mais c’est la Belgique qui servira de passerelle (avec Van de Velde et Elskamp), ce seront là les « nouvelles terres d’expérience du livre idéal ».
Alibert consacre plusieurs pages à la succession du célèbre imprimeur, aux « transferts esthétiques ». Elle repère l’influence de Morris sur Charles Robert Ashbee, sur Cobden-Sanderson qui, prenant ses distances avec la surabondance et la profusion décorative, cherche à conceptualiser davantage le livre idéal en adoptant l’équilibre des lettres romaines dont il trouve le modèle dans l’Historia naturalis de Pline imprimé à Venise par Nicolas Jenson en 1496. Il y aura également le graveur Lucien Pissarro (1863- 1944), fils du peintre Camille Pissaro, admirateur de Morris dont il poursuit l’idéal. Il s’établira en Angleterre où il rencontre Charles Rickett et fonde l’Eragny Press dont Alibert détaille les difficultés commerciales, financières et créatrices. Pissarro choisit d’illustrer des livres contemporains (en oubliant de tenir compte des droits d’auteur) et son style se trouve marqué par une sorte d’hybridité ; ni anglais, ni français, il est qualifié d’ « apatride ». En 1947, sa veuve, Esther Pissarro, jette les matrices dans la Manche « à équidistance des côtes anglaises et françaises » pour bien marquer la double appartenance de son mari aux deux pays qu’il aimait également.
Alibert clôture son étude en se demandant si les Cranach Press créées par le comte Harry Kessler (1868-1937) à Weimar n’ont pas réalisé le sommet du transfert culturel de Morris en tuant le père. Des artistes comme Aristide Maillol et son neveu Gaspard (il fabrique un papier sublime), de même que Edward Gordon Craig (3) participent à la réalisation des bois gravés pour les Églogues de Virgile et pour le Hamlet de Shakespeare. Ce dernier sera du reste considéré comme le parachèvement du livre illustré, tant par la qualité intellectuelle (recherche des sources, des commentaires, du contenu) que par celle du visuel. La réussite de Kessler qui a pu être à la fois commerciale et esthétique (il décèdera toutefois ruiné) s’expose dans une édition des classiques, soignée et accessible. Le comte collabore en effet avec l’Insel Verlag pour créer la série du Grossherzog Wilhelm Ernst éditant les classiques allemands dont le succès esthétique et commercial durera jusqu’aux années 1920.
Avec son essai, Florence Alibert n’a pas seulement cherché à pro-
duire une vision historique de l’œuvre de William Morris, elle en réalise aussi une forme de bouture. L’ « unité » visée par Morris fait du livre le véhicule de toute une vision du monde qui se communique à travers le choix d’éléments et de moyens qui pourraient passer pour anodins, superfi-
ciels ou insignifiants, mais qui se révèlent en réalité pleins de sens. L’insignifiant en apparence, combiné à d’autres détails, produit toujours des effets qui, pour être discrets ou secrets, n’en demeurent pas moins considérables (4).
Chakè MATOSSIAN
––––––
(1) Ruskin a donné des cours aux futurs artisans graveurs de l’Université d’Oxford. Pour lui graver est un acte par lequel on confère une permanence à ses idées, il n’y a pas de repentirs en gravure : « Engraving […] is essentially the cutting into a solid substance for the sake of making your ideas as permanent as possible ». Cf. Laurence Roussillon-Constanty, « L’empreinte selon John Ruskin », in Empreinte, imprégnation, impression, sous la dir. de L. Roussillon-Constanty, D. Vaugeois et M. Parsons, Presses Universitaires de Pau, 2014, p. 137.
(2) Geoffrey Chaucer (1340-1400) a écrit son poème Anelida and Arcite vers 1370. Basé sur un récit de Boccace, il raconte l’histoire d’une reine arménienne courtisée par un Grec, Arcite. Voir par ex., Zohrab Gevorgyan, “Cilician Armenia in Early Renaissance Literature”, in
(3) Nous signalons en passant que Gordon Craig, célèbre pour ses inventions de décors de théâtre et ses fabrications de marionnettes, avait été l’ami du père de Jurgis Baltrušaitis et avait fortement marqué ce dernier lorsqu’il était enfant.
(4) En ce qui concerne la relation entre typographie et pouvoir, l’on renverra au livre passionnant de Jérôme Peignot, De l’écriture à la typographie, Gallimard, 1967.
© 2022 Tous droits réservés